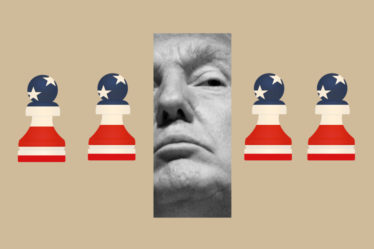Pour la coalition, les choses étaient bien différentes. Les forces occidentales ont eu accès à un large éventail de technologies de classe mondiale, de la surveillance spatiale aux systèmes télécommandés comme les robots et les drones. Mais pour eux, la guerre en Afghanistan n’était pas une guerre de survie ; c’était une guerre de choix. Et pour cette raison, une grande partie de la technologie visait à réduire le risque de pertes plutôt qu’à remporter une victoire pure et simple. Les forces occidentales ont lourdement investi dans des armes qui pourraient mettre les soldats hors d’état de nuire – puissance aérienne, drones – ou des technologies qui pourraient accélérer la délivrance de soins médicaux immédiats. Les choses qui gardent l’ennemi à distance ou protègent les soldats des dommages, comme les hélicoptères de combat, les gilets pare-balles et la détection des bombes en bordure de route, ont été au centre de l’attention de l’Occident.
La priorité militaire primordiale de l’Occident a été ailleurs : dans la bataille entre les grandes puissances. Technologiquement, cela signifie investir dans des missiles hypersoniques pour correspondre à ceux de la Chine ou de la Russie, par exemple, ou dans l’intelligence artificielle militaire pour essayer de les déjouer.
La technologie n’est pas un moteur de conflit, ni un garant de victoire. Au lieu de cela, c’est un facilitateur.
Le gouvernement afghan, pris entre ces deux mondes, a fini par avoir plus de points communs avec les talibans qu’avec la coalition. Ce n’était pas une guerre de choix mais une menace fondamentale. Pourtant, le gouvernement ne pouvait pas progresser de la même manière que les talibans ; son développement a été entravé par le fait que les militaires étrangers fournissaient les principales forces technologiquement avancées. Alors que l’armée et la police afghanes ont certainement fourni des corps au combat (avec de nombreuses vies perdues dans le processus), elles n’ont pas été en mesure de créer ou même d’exploiter des systèmes avancés par elles-mêmes. Les pays occidentaux étaient réticents à équiper les Afghans d’armes de pointe, craignant qu’elles ne soient pas entretenues ou qu’elles ne finissent même entre les mains des talibans.
Prenez l’armée de l’air afghane. Il était équipé et entraîné sur moins de deux douzaines d’avions à hélices. Cela a permis un minimum de soutien aérien rapproché, mais c’était loin d’être à la pointe de la technologie. Et travailler avec les États-Unis signifiait que l’Afghanistan n’était pas libre de chercher ailleurs pour le transfert de technologie ; il était, en effet, coincé dans une phase de développement rabougri.
Alors qu’est-ce que cela nous dit? Il dit que la technologie n’est pas un moteur de conflit, ni un garant de la victoire. Au lieu de cela, c’est un facilitateur. Et même des armes rudimentaires peuvent l’emporter entre les mains d’humains motivés et patients qui sont prêts et capables de faire tous les progrès nécessaires.
Cela nous dit également que les champs de bataille de demain pourraient ressembler beaucoup à l’Afghanistan : nous verrons moins de conflits purement technologiques qui seront gagnés par les militaires avec la plus grande puissance de feu, et plus de technologies anciennes et nouvelles mises en œuvre côte à côte. Cela ressemble déjà à des conflits tels que celui entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et le modèle en est un que nous verrons peut-être davantage avec le temps. La technologie ne gagne peut-être plus les guerres, mais l’innovation le peut, en particulier si une partie mène une bataille existentielle.
Christophe Ankersen est professeur agrégé clinique d’affaires mondiales à l’Université de New York. Il a servi aux Nations Unies en Europe et en Asie de 2005 à 2017 et dans les Forces armées canadiennes de 1988 à 2000. Auteur et éditeur de plusieurs livres, dont La politique de coopération civilo-militaire et TL’avenir des affaires mondiales, il est titulaire d’un doctorat de la London School of Economics and Political Science.
Mike Martin est un ancien officier de l’armée britannique parlant le pashto qui a effectué plusieurs missions en Afghanistan en tant qu’officier politique, conseillant les généraux britanniques sur leur approche de la guerre. Il est maintenant chercheur invité en études de guerre au King’s College de Londres et auteur de Une guerre intime, qui retrace la guerre dans le sud de l’Afghanistan depuis 1978. Il est titulaire d’un doctorat du King’s College de Londres.